
COHÉSION NATIONALE : L’APPORT DES MOUVEMENTS ESTUDIANTINS, L’EXEMPLE DE NDÈF LÈNG ET KEKENDO

Au Sénégal, l’université n’est pas seulement un lieu de transmission du savoir. Elle est aussi un microcosme de la société, où cohabitent, se confrontent et se réconcilient les multiples identités culturelles, ethniques et sociales du pays. À l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), cette réalité est particulièrement perceptible à travers l’existence de mouvements estudiantins culturels comme Ndèf Lèng ou Kekendo. Ces associations, souvent réduites à leur dimension folklorique ou communautaire, jouent pourtant un rôle capital dans la construction de la cohésion nationale, dans un contexte parfois tendu, voire conflictuel.
Le Kekendo : Une réponse à l’injustice sociale
Le Kekendo, qui signifie « guerrier » en mandingue, est né en 2001 dans un climat d’exclusion et de marginalisation. Comme le rappelle Franck Daddy Diatta, juriste et ancien membre du mouvement : « Kekendo est le mouvement pour le développement de la Casamance. Il est né face aux injustices dans l’octroi des œuvres sociales du COUD, en particulier pour les étudiants venus de la Casamance naturelle. »
Ce mouvement s’est constitué autour de l’unité dans la diversité, rassemblant Mandingues, Diolas, Peuls, Sérères, Mandjacks ou encore Wolofs du Sud. Son objectif : offrir un cadre d’équité, de solidarité et de valorisation culturelle pour les étudiants de cette région souvent marginalisée.
Ndèf Lèng : L’affirmation identitaire dans un esprit d’ouverture
Le Ndèf Lèng, quant à lui, incarne une dynamique culturelle centrée sur la valorisation de l’identité sérère. Mais loin d’être un repli ethnique, ce mouvement se veut inclusif et œuvrant pour le dialogue interculturel. Il participe à des initiatives conjointes avec d’autres mouvements, notamment Kekendo, pour bâtir une cohabitation pacifique au sein de l’espace universitaire.
Campus universitaire : lieu de brassage, de dialogue et de citoyenneté
Ces mouvements ne se contentent pas de promouvoir leur culture ; ils participent activement à la construction d’un vivre-ensemble universitaire et national. À travers des symposiums, tournois inter-associations, débats citoyens, journées culturelles unifiées, ces organisations permettent aux étudiants de se découvrir dans leurs différences, et surtout, de se comprendre au-delà des préjugés ethniques ou régionaux.

Pour Franck Daddy Diatta : « Ces mouvements réduisent considérablement les velléités de conflits. Ce sont des cadres où différentes ethnies échangent et se fréquentent, favorisant une paix durable. »
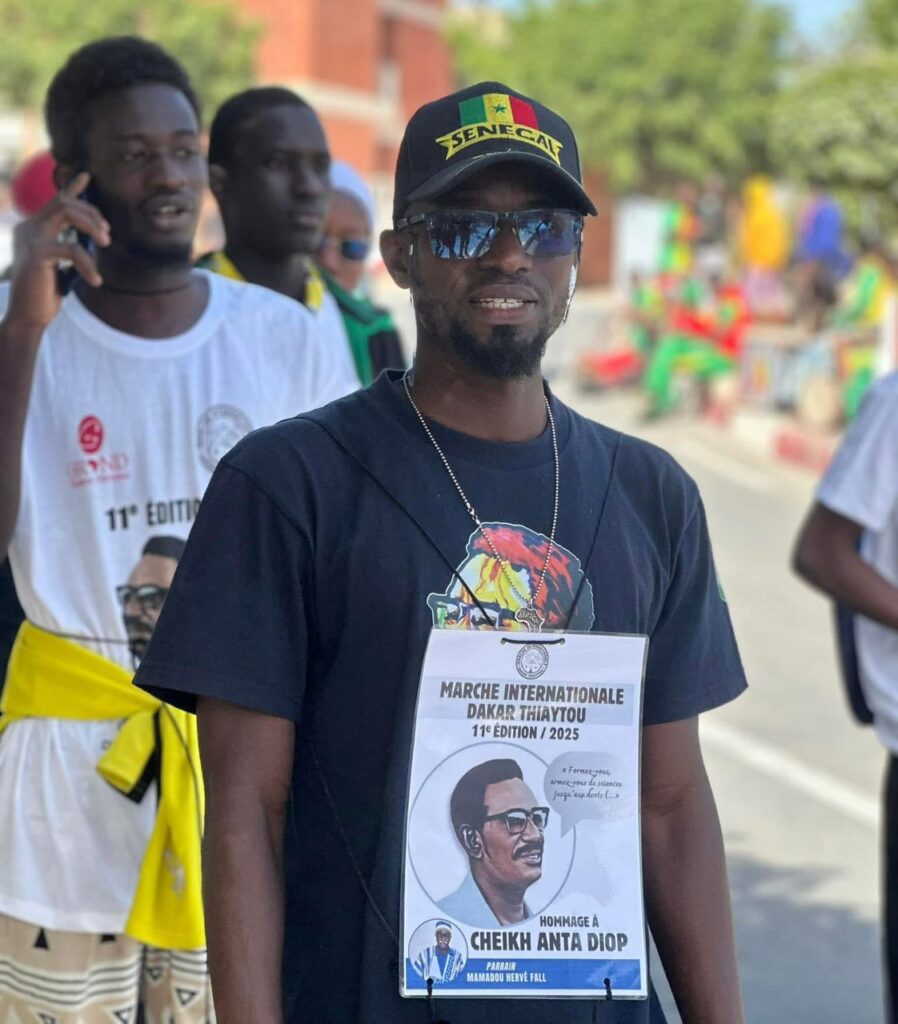
Et pour Mansour Sène, ancien syndicaliste et acteur culturel : « Le cousinage à plaisanterie entre les ethnies y est très présent. Cela permet de désamorcer les tensions. Un Peul, un Sérère, un Diola peuvent se taquiner en toute fraternité. Cette pratique culturelle ancestrale est vivace dans l’université, et les mouvements comme Ndèf Lèng ou Kekendo l’entretiennent. »
Entre traditions et leadership émergent : l’école de la citoyenneté
Au-delà de la culture, ces mouvements forment des leaders. Ils initient leurs membres à la gestion, à la prise de parole publique, à la médiation, à l’organisation d’événements et à l’engagement social.
Pour Diatta : « Ndèf Lèng et Kekendo sont des lieux de socialisation politique et citoyenne. Ils préparent les étudiants à la vie publique, à la responsabilité et à la gestion des différences. »
Cependant, des limites sont aussi pointées. Comme le rappelle Mansour Sène : « Ces mouvements ne sont pas issus d’un processus électif organisé par les facultés. Leur légitimité est parfois contestée. Tous les étudiants ne s’y retrouvent pas forcément. »

D’où la nécessité, selon lui, d’un encadrement institutionnel plus fort, pour éviter toute dérive identitaire ou monopole dans la représentation des étudiants.
Les recommandations sont claires. Pour Abdoulaye Ndoye, sociologue, pour renforcer cette cohésion et ce bon vivre-ensemble, il faut renforcer les capacités organisationnelles de ces mouvements. En outre, assurer un accompagnement financier transparent pour leurs activités. Mais aussi, selon, encadrer leur action par un cadre institutionnel clair, sans dénaturer leur autonomie.
Le sociologue Ndoye recommande aussi de favoriser une dynamique d’inclusion, où les étudiants ne se définissent pas uniquement par leur origine mais aussi par leur citoyenneté sénégalaise partagée.
Comme le souligne Franck Daddy Diatta : « Ils doivent être sensibilisés sur leur rôle dans la stabilité du pays. C’est un devoir national. »

L’unité dans la diversité, un projet en construction
Les mouvements culturels à l’UCAD, loin d’être de simples regroupements folkloriques, sont des laboratoires vivants de la cohésion nationale. Ndèf Lèng, Kekendo et d’autres structures étudiantes jouent un rôle inestimable dans l’apprentissage de la tolérance, du respect mutuel et de la citoyenneté active.
À l’heure où les clivages identitaires menacent bien des nations africaines, le Sénégal offre, à travers ses universités, une preuve vivante que diversité peut rimer avec unité, si tant est qu’on lui offre un cadre structuré, juste et équitable pour s’exprimer.
Franck Daddy Diatta : « Kekendo est un cadre qui rassemble les fils de la Casamance de toutes ethnies pour faire bloc contre l’injustice et pour promouvoir une diversité culturelle pacifiée. »
Mansour Sène (Colonel) : « Le cousinage à plaisanterie est notre ciment social. Ndèf Lèng et Kekendo, c’est la preuve que l’université peut être un levier de paix et d’unité nationale. »


Mamadou DIOP






